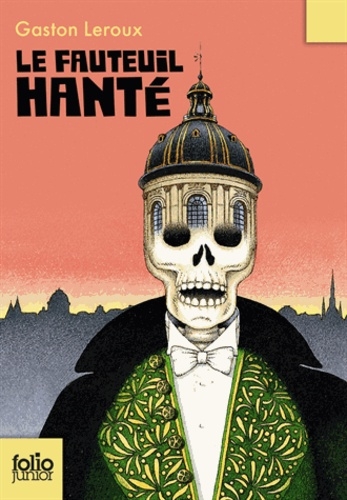Si, au début de XVIIIe siècle, le grand-père de Gustave Eiffel (1832-1923) n'avait pas fait ajouter à son nom le surnom plus aisément prononçable d'Eiffel, massif boisé de Rhénanie-du-Nord en Allemagne dont il était originaire, notre monument national aurait pu s'appeler la Tour Bönickhausen-Eiffel ! Et c'est bien ce double nom de « Bönickhausen dit Eiffel » qui a longtemps été porté par la famille jusqu'à ce que, à la demande de l'ingénieur centralien, l’autorisation de porter le seul patronyme d’Eiffel lui soit accordée par décret du 1er avril 1879 suivi d'un jugement du tribunal de première instance de Dijon en date du 15 décembre 1880 et ce en raison de la consonance allemande qui pouvait « inspirer des doutes sur sa nationalité française de nature à lui causer, soit individuellement, soit commercialement, le plus grand préjudice » .

Gustave Eiffel en famille avec femme et enfants
Alors que le devis de construction de « sa » tour s'élevait à 8 millions de francs-or, Eiffel, en gestionnaire scrupuleux, présenta une facture d'exactement ….7 799 401,31 francs ! Autre temps, autre mœurs !

Fleuron de l'exposition universelle de 1889, année du centenaire de la Révolution française, le jour de la clôture, le 31 octobre, Gustave Eiffel, qui s'était aménage un salon d’accueil au sommet de sa tour, y reçu le savant américain Thomas Edison (1847-1931) lequel lui fit présent d'un de ses phonographes capable d'enregistrer des sons sur un rouleau de cire.

Gustave Eiffel et Thomas Edison
On sait que l'édification de la tour Eiffel a fait couler beaucoup d'encre ! Bien des personnalités de l'époque se sont acharnées à la dénigrer. A l'image du normand Guy de Maupassant (1850-1893) : « Je me demande, écrivait-il, ce qu'on conclura de notre génération si quelque prochaine émeute ne déboulonne pas ce squelette disgracieux et géant. »