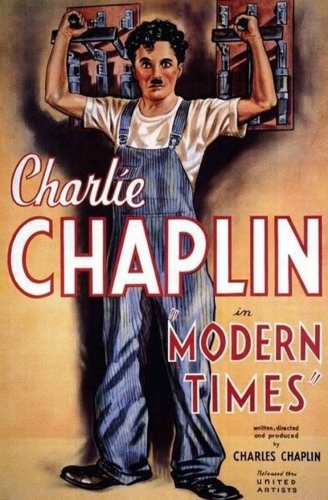Étymologiquement, elles tirent leur nom de leur forme de lune. Et si elles concernent aujourd'hui, parce qu'ils ont des problèmes de vue, près de 70% de la population ! Les grandes civilisations de l'Antiquité, Égyptiens, Grecs et Romains, ne connaissaient pas les lunettes ! Dès le Moyen-âge, dans les monastères, pour déchiffrer les documents, les moines utilisent une « pierre de lecture », sorte de loupe grossissante faite d'un morceau de verre bombé à poser.

Besicles en cuir, 16ème siècle - Musée de la lunette de Morez
Les premières aides visuelles, les « bésicles » seraient apparues en Italie à la fin du XIIIe siècle. Seuls les Vénitiens sont en mesure à cette époque de fabriquer du verre blanc totalement incolore. Fabriquées à l'aide de deux verres convexes ronds enchâssés dans des cercles attachés individuellement à des manchons reliés entre eux à l'aide d'un clou, elles améliorent la presbytie. C'est vraisemblablement l'invention de l'imprimerie qui ba démocratiser leur usage. Au XVe siècle, avec l'apparition des verres concaves corrigeant cette-fois la myopie, le clou est remplacé par un pont arrondi fabriqué dans des matériaux « nobles » comme le bois, l'écaille de tortue, l'ivoire ou l'os. Un siècle plus tard, on y adjoint un ruban à nouer derrière le crâne.

Lunettes en corne et en cuir avec lanières pour les oreilles, Japon 18ème siècle
Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, qu'un opticien anglais à l'idée de les munir de branches très courtes à coincer sous les perruque. Quand ces dernières seront passées de mode, peu avant 1789, les branches vont s'allonger et s'arrondir jusqu'à derrière les oreilles, signant ainsi la forme que nous connaissons aujourd'hui.

Félix Jansé (1880) - Le Monocle - Cavalier Dandy
Cependant, les bourgeois des XVIIIe et XIXe siècles feront de la résistance. A ces lunettes à branches, ils préféreront monocles, pince-nez, binocles et autres faces-à-main, autant d'accessoires de mode qu'ils portent comme des bijoux.